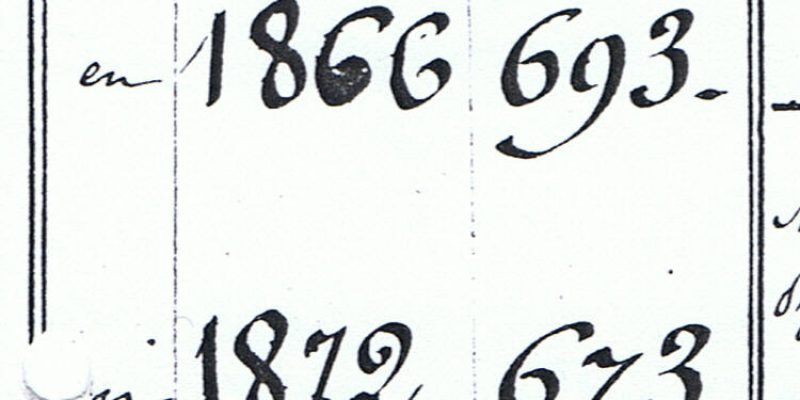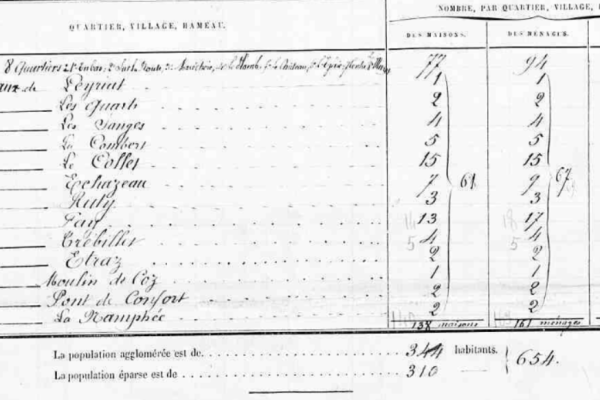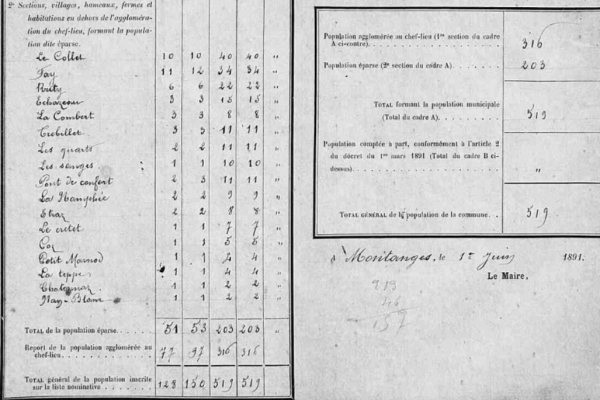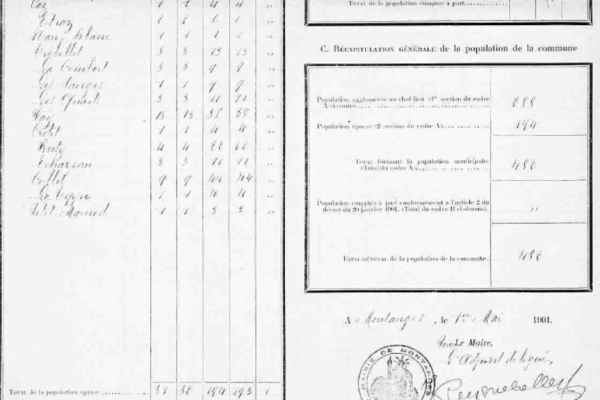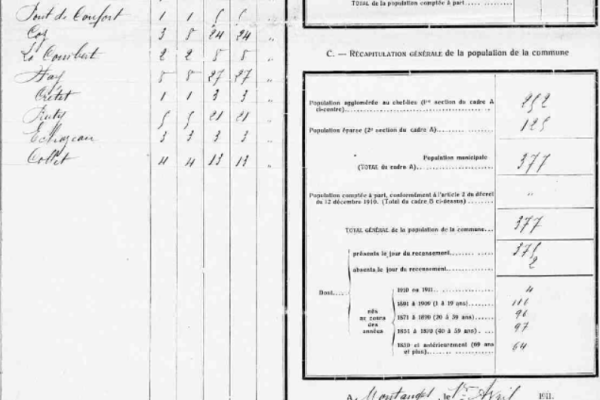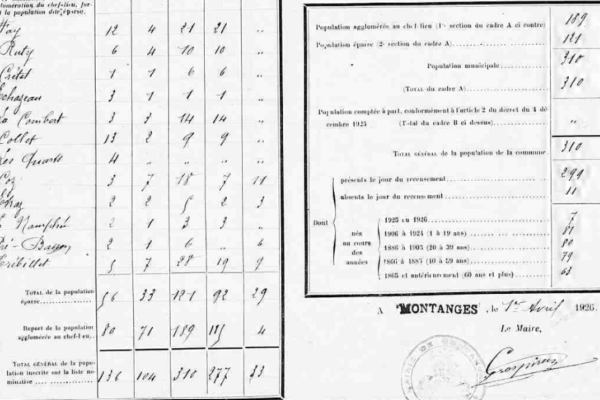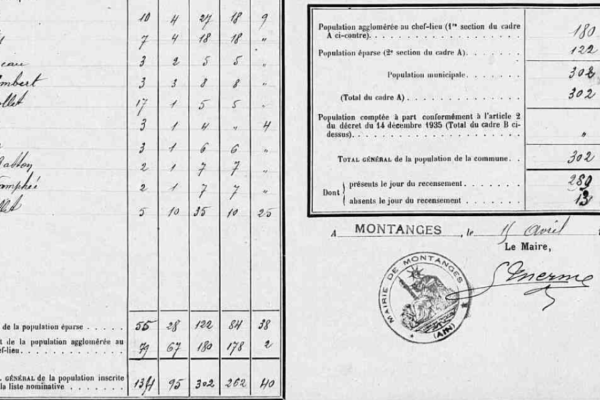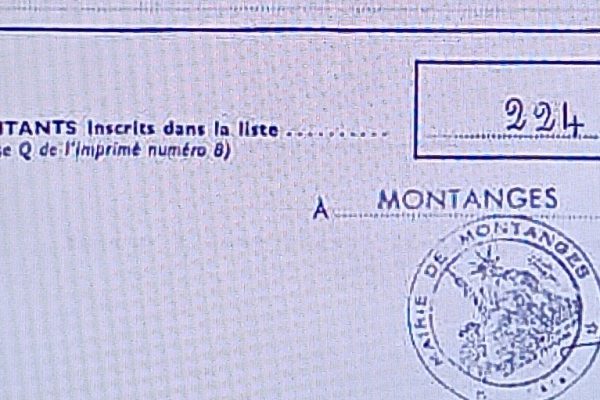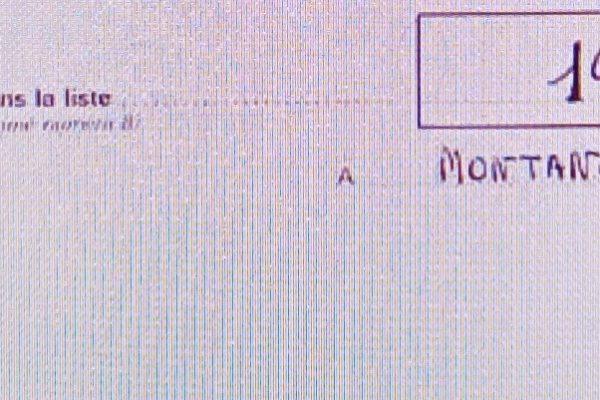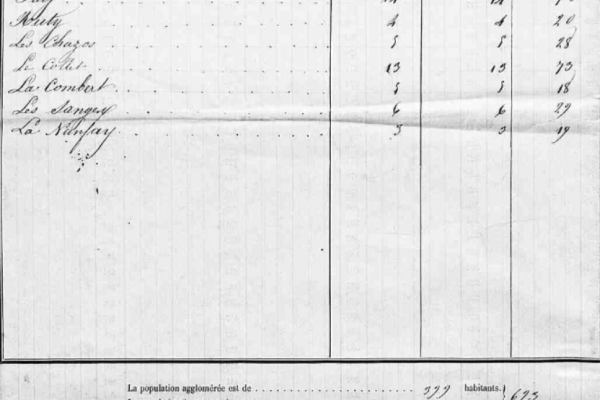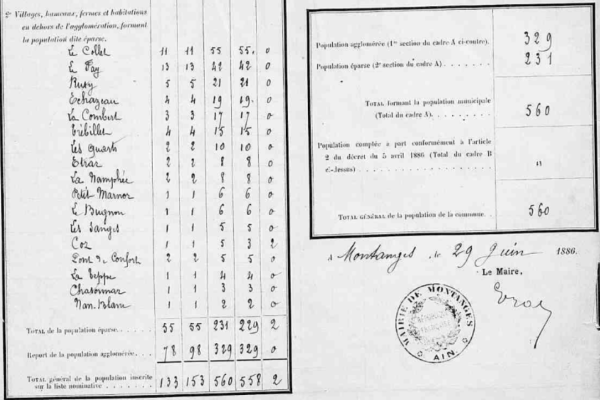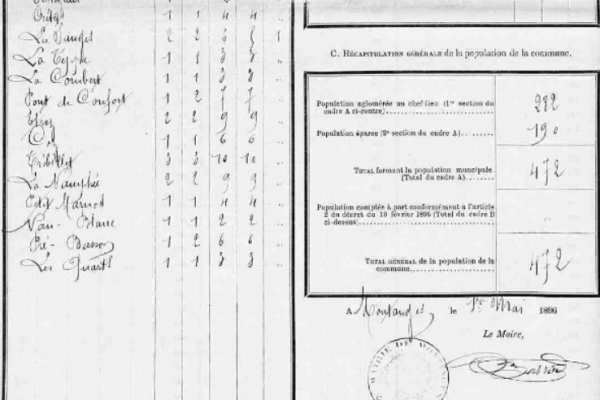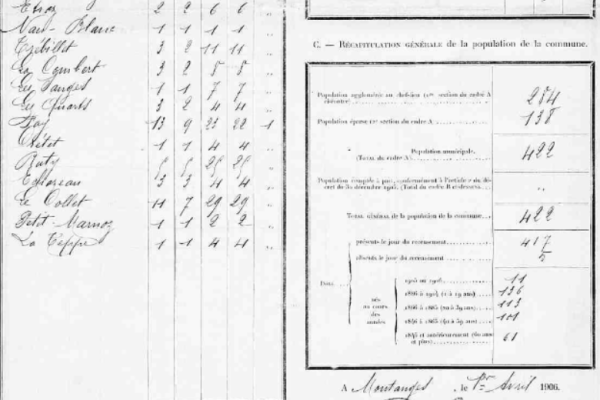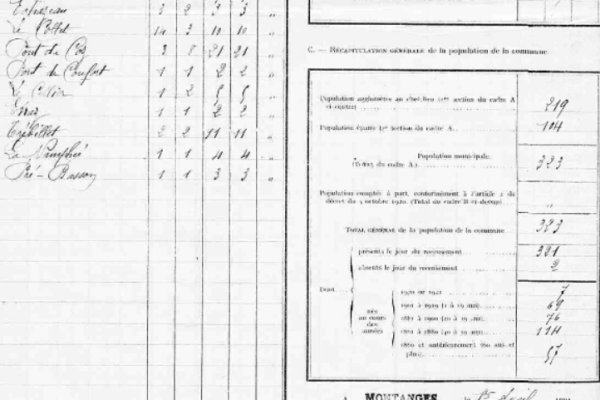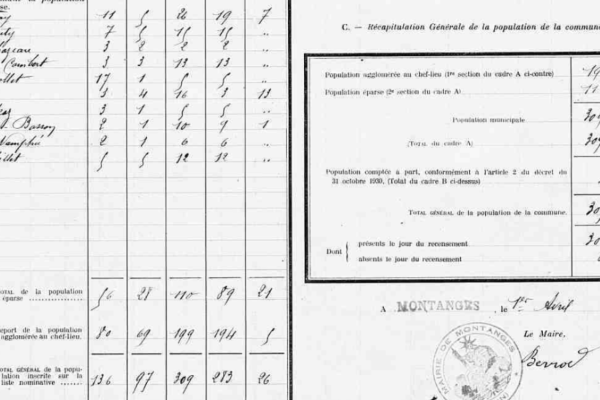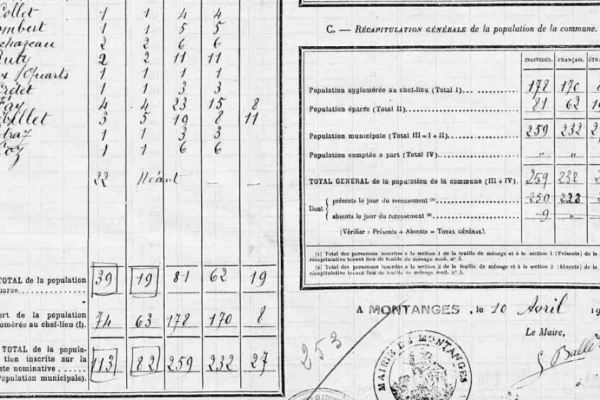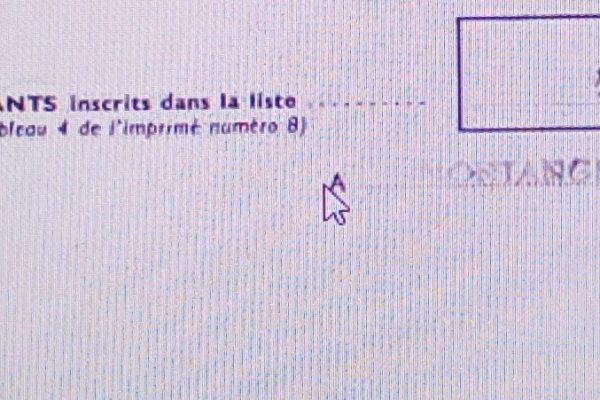Retrouvez toutes les archives
sur Montanges
Naissance de Montanges
Monsieur Debombourg, chargé du classement des archives départementales a donné en 1856 une hypothèse sur les origines de Montanges et de la Michaille :
« Le mot générique viendrait d’une ancienne chapelle dédiée à Saint Michel qui existait encore au septième siècle sur la montagne au-dessus de Montanges où l’archange aurait posé son pied sur ce mont d’où la désignation du Mont de l’ange et donc Montanges. La chapelle aurait donné également son nom à la vallée : « La vallée de Michel » d’où la Michaille et le village de Chatillon dont le château était dénommé le Château de Michel.
Pour d’autres historiens locaux la Michaille serait la Villa ou domaine d’un général romain du nom de Valérius Michel.
En 1770, des ouvriers auraient mis à jour sa sépulture en effectuant des travaux dans le jardin de la maison du docteur Passerat.
Cette pierre fut mise de côté au cimetière d’Ardon en attendant d’en savoir plus.
Quelques années plus tard après avoir relevé les inscriptions gravées, il fut possible d’en comprendre le texte :
« Aux dieux Manès, à la mémoire éternelle de Valérius Michel, maître de ce domaine, son épouse Volumnia a élevé ce tombeau. »
Alors la Michaille ne serait-elle pas simplement la terre de Michel et donc rien à voir avec la dévotion à l’archange comme on le croyait.
Montanges a donc bien connu un premier habitat avant l’arrivée des moines de Nantua et plusieurs graphies anciennes mentionnent : Montangio en 1299 et Monte Angio en 1326.
Dans le doute des deux possibilités nous retiendrons sans modération la première car lorsque parfois la légende est plus belle qu’une certaine réalité nous n’hésitons pas à privilégier cette légende !
S’il y un doute sur l’existence même du village de Montanges, il est à peu près certain que le hameau de Fay existait à cette époque. Fay, situé dans la combe fertile du Nan Blanc était situé sur le passage d’une ancienne voie romaine reliant la cluse de Nantua via Trébillet à l’abbaye de Saint Claude par la combe du Collet et Giron.
Une ancienne chapelle dédiée à Saint Michel dominant la vallée de Michaille aurait pu appartenir au hameau.
Quant au village de Montanges il n’était qu’un pays encore primitif presque inhabité.
D’immenses forêts de sapins et de hêtres couvraient les flancs des montagnes dans lesquelles vivaient de nombreuses bêtes sauvages. Le premier soin des abbés de Nantua fut d’établir au milieu de ces profondes forêts des colons pour en défricher le sol.
Ils choisirent ainsi des lieux qui, de par leur topographie étaient les mieux défendus par la nature ainsi que contre les bêtes féroces. Ainsi apparurent Montanges, Ruty, Echazeau et le Crétet.
Au fil des siècles si la Michaille fut bien gauloise, romaine, soumise aux Dauphins de Viennois, aux Sires de Thoire et Villars puis à ceux de Savoie, avant d’intégrer le royaume de France, les habitants du village de Montanges qui est inclus depuis le dixième siècle dans la terre monastique de Nantua dépendant de Cluny ont toujours été des sujets du Roi de France.
Jusqu’au milieu du XIX° Montanges s’est toujours écrit sans le « S » final.
Légendes et traditions
Quelques Légendes et traditions locales ont toutefois perduré jusqu’au milieu du XX°
La Jeanne du Moulin des Pierres : Les villageois attribuaient les malheurs du village à l’influence maligne de la fameuse Jeanne, ancienne châtelaine de Montanges, sur le compte de laquelle on mettait des aventures qui faisaient d’elle une autre Marguerite de Bourgogne.
D’autre part son influence était combattue par les curés qui pouvaient « couper le feu ». Mais les curés ne voulaient pas toujours, aussi, quand survenaient des incendies les montangers prétendaient ne pas avoir de bons curés .
Au moulin des pierres, on disait qu’on entendait la Jeanne ricaner dans les profondeurs du gouffre dans les resses du moulin. On ne passait pas dans ce lieu, le long des éboulis sans se signer et sans invoquer Saint-André, patron de la paroisse.
Une deuxième version dit que les rochers du moulin des pierres, seraient tombés une nuit de Noël, sur le moulin au bord de la rivière et que l’on entendait la Jeanne pleurer la perte de ses biens.
Le mouton de la croix du Part : Un peu au-dessus de la tour de la Bâtie, se trouve la croix du Part, lieu redouté tant par son isolement que par la rencontre qu’on y fait à minuit : un mouton ensorcelé s’y tient à l’affût ; il se plait à égarer le voyageur et à le faire choir dans un précipice. Lorsque sa ruse a réussi, il célèbre sa victoire par un bêlement féroce.
On y voit également des fantômes dansant des rondes autour de la croix.
Le rocher de Prébasson : Lieu sinistre : Un capucin se tient dans le rocher, il sort au son d’une cloche, précédé d’un minuscule enfant de chœur. (Récit de l’abbé Tournier en 1773).
La mère Gongon : C’était une vieille femme du village que l’on ne voyait jamais mais dont la légende entretenait savamment la mémoire, pour faire peur aux petits enfants qui n’étaient pas sages.
Le patier jeteur de sorts : Sa maison, située aux Carres était sinistre et les villageois qui avaient peur du sorcier, n’osaient s’aventurer dans cette région. La rumeur dit qu’il possédait des livres dans lesquels il puisait sa science maudite pour jeter des sorts aux gens et aux animaux. Sa maison est maintenant en ruine.
L’ours de la Chandeleur : A la Chandeleur, l’hiver cesse ou prend vigueur.
Si à la Chandeleur l’ours voit ses quatre montagnes, il rentre dans sa tanière pour 40 jours.
Carnaval : Les enfants se déguisaient avec de vieux habits et passaient dans les maisons où on les remerciait de leur visite avec quelques bugnes et quelques pièces ; C’étaient « les Masques ».
Les cloches de Pâques : Le jeudi saint, les cloches partaient à Rome en carillonnant.
Les enfants prenaient alors les cloches des vaches et les agitaient en courant dans le village pour remplacer les sonneries.
Les conscrit : Le jour du conseil de révision, lorsque le soir arrivait, après maintes libations, les conscrits passaient dans les maisons, quémandaient des œufs, du pain, du vin et faisaient au café, une gigantesque omelette bien arrosée.
Le Buis béni : Les soirs d’orage, on fait brûler dans les maisons, le buis béni le jour des Rameaux, pour se protéger de la foudre.
La Pogne : Plusieurs fois par semaine, dans les différents quartiers, une bonne odeur de pain frais se répandait car on « faisait au four ». La grand-mère de la maison gardait la dernière boule de pâte qu’elle partageait et cuisait pour ses petits-enfants : ils avient chacun leur « pogne ».
La vogue : La fête patronale de la Saint-André fixée au dernier dimanche de novembre était l’occasion de joyeux repas où les familles étaient rassemblées. On cuisinait des poulets élevés pour la circonstance et on « cuisait au four » les gratins de pomme de terre, les tartes aux pruneaux, les « papets » et les tartes aux poires curé ou aux poires blossons, sans oublier les délicieuses meringues.
Les quilles : L’été, le jeu du dimanche après-midi pour les hommes, était le jeu de quilles dont les parties se terminaient souvent au café. Le jeu de quilles à côté de chez la mère Mathieu était le plus réputé.